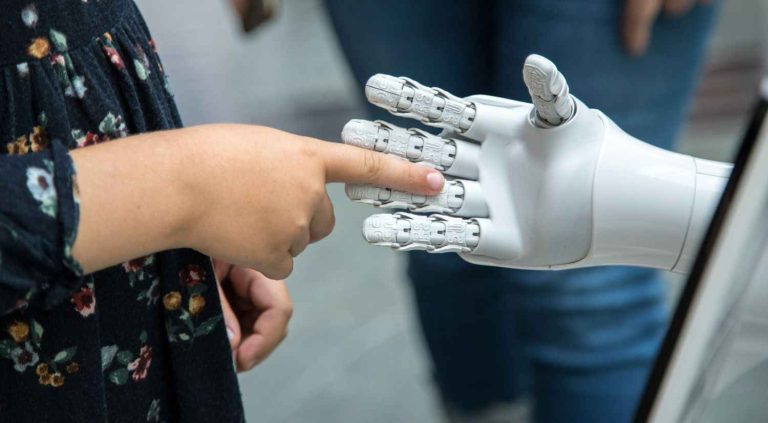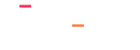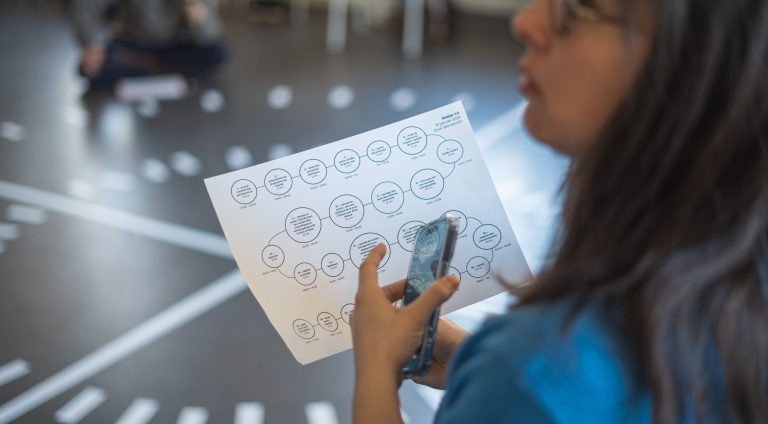Vos recherches sur les déplacements collectifs des fourmis ont permis d’identifier leurs mécanismes de régulation du trafic. Est-il exact qu’elles ne génèrent jamais d’embouteillage ? Leur organisation présente-t-elle des points communs avec la nôtre ?
Les fourmis n’ont pas toutes les mêmes règles de circulation. Certaines espèces se rapprochent plutôt du mode de fonctionnement des piétons et d’autres des automobiles. Aux États-Unis, j’ai étudié des colonies qui transportent des charges. Elles sont toutes de tailles différentes. Celles qui sont chargées du transport circulent beaucoup plus lentement que les autres, à la manière des camions sur les autoroutes. Nous les avons observées pour voir si elles se font doubler par les fourmis non chargées. Quand un véhicule roule à 70 km/h, et qu’un autre le double à 75 km/h, cela créé un embouteillage pour ceux qui roulent derrière à 90 km/h. Chez les fourmis, on ne retrouve pas ce phénomène. Les fourmis non chargées préfèrent rester derrière leurs congénères chargées, plus lentes, mais qui bénéficient de la priorité par rapport aux autres. Il y a un ensemble de règles de priorité comme celles-ci qui expliquent l’absence d’embouteillages chez ces fourmis. La différence fondamentale entre elles et nous, c’est que les fourmis qui sont sur les pistes de récolte alimentaire partagent un même objectif : ramener de la nourriture pour le nid. Alors que quand nous sommes sur la route, nous avons tous un objectif individuel.
Chez d’autres espèces, les fourmis ont toutes la même taille et elles avancent à la même vitesse, comme des piétons. Elles transportent la nourriture à l’intérieur de leur corps en la buvant sur place. Les règles de priorité ne sont alors plus les mêmes. Il n’y a pas de différence entre qui vient de la nourriture et qui va à la nourriture. La priorité revient à celle qui a le plus la capacité d’éviter physiquement les autres individus. Il s’agit d’un ajustement qui se fait automatiquement, un petit peu comme si vous aviez des feux rouges et des feux verts qui s’adapteraient en permanence à la situation. Nous avons récemment montré que les fourmis sont également capables de créer des architectures pour fluidifier le trafic. Chez les humains, il a été montré que si l’on installait des piliers au milieu des couloirs de métro, cela structurait le trafic en divisant le flux. Les fourmis, elles, fabriquent leurs propres piliers pour fluidifier leur trafic.
Mais la principale différence entre les humains et les fourmis réside dans le fait que quand ces dernières courent à grande vitesse et rentrent dans une autre fourmi, elles ne se font pas mal : elles ont un exosquelette et l’inertie liée à leur poids fait que le choc n’est pas fort. Si nous nous comportions comme elles, à courir partout en se rentrant dedans, cela aurait de graves conséquences ! La proximité entre humains est donc plus dangereuse qu’entre fourmis. Ces dernières sont de plus très altruistes : elles se soignent et s’entraident, même en cas de panique. Si l’une d’entre elles est piégée dans une toile d’araignée, les autres vont la chercher.
Quelles techniques utilisez-vous pour étudier ces mouvements dans les colonies ?
J’ai longtemps partagé le bureau de Mehdi Moussaïd. Il étudiait les foules humaines et moi les foules de fourmis, mais nous faisions les mêmes expériences. Nous étudions le comportement soit des petites colonies de 1000 individus, soit de plus de 25000 individus, en variant les densités. Nous observons comment elles s’organisent en fonction de la densité d’individus, en les faisant emprunter un ou des ponts qui mènent à une source de nourriture. Nous avons établi lors de certains tests que les fourmis choisissent toujours les solutions les plus optimales en termes de déplacement. Parfois, prendre une route plus longue, si elle n’est pas embouteillée, permet d’arriver plus vite que si l’on a emprunté une voie plus courte, mais embouteillée. Les humains se font souvent avoir quand ils doivent faire ces choix, mais les fourmis non.
Nous filmons les colonies et nous traitons les images grâce à des logiciels d’analyse qui permettent d’extraire les trajectoires des fourmis et de voir la trajectoire individuelle de chacune d’entre elles. On récolte ainsi des données d’une immense richesse. Nous avons pu en tirer un modèle mathématique du comportement des fourmis.
Peut-on parler d’intelligence collective chez les fourmis ?
Il a été démontré que leurs capacités collectives sont nettement supérieures à leurs capacités au niveau individuel. Une fourmi qui circule toute seule ne sera pas capable de sélectionner le chemin le plus court, alors qu’en groupe c’est le cas. L’intelligence collective naît des interactions entre toutes les fourmis. Chacune fait une partie du travail, a une partie de l’information, qu’elles mettent en commun. C’est ce que l’on appelle des processus d’émergence. J’ai beaucoup travaillé sur la décision collective chez les fourmis, surtout dans le contexte alimentaire et il est assez frappant de voir à quel point elles sont capables de résoudre des problèmes comme choisir des aliments selon leur composition, grâce aux infimes préférences de chacune d’entre-elles.
Nous venons, en 2024, de publier notre dernière découverte. Nous avons, en laboratoire, montré qu’une colonie de fourmis rendue malade est capable de changer de stratégie de récolte alimentaire en allant chercher des protéines pour booster leur système immunitaire et produire la réponse à l’infection. Il s’agit là d’un premier cas démontré d’automédication collective.