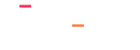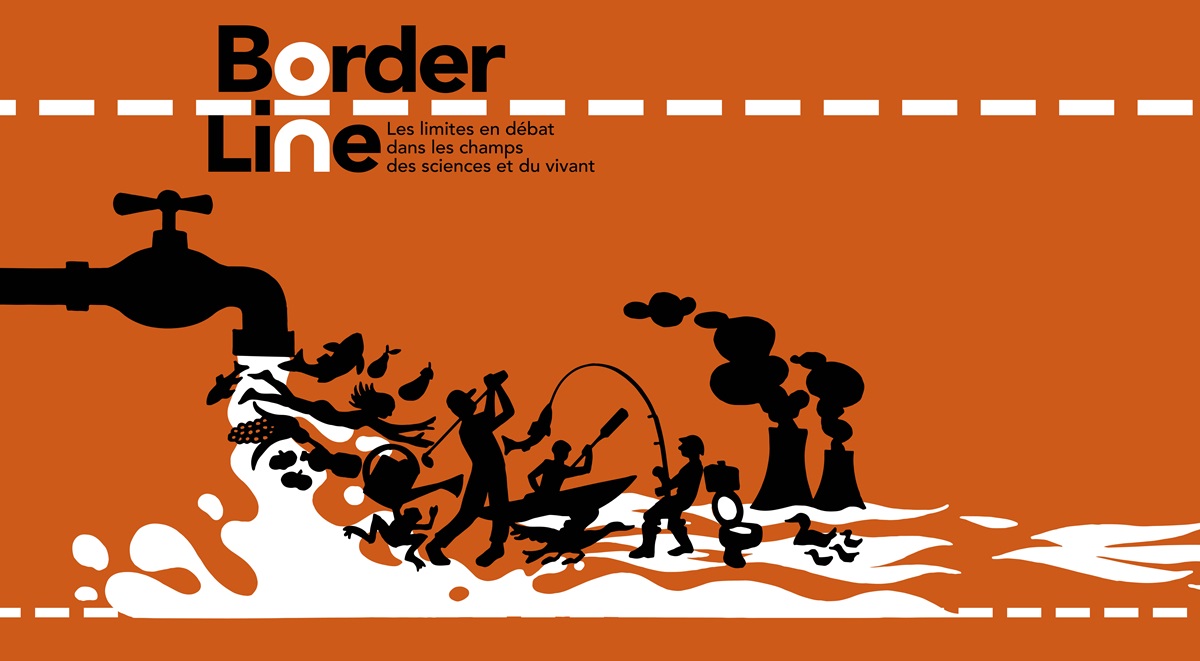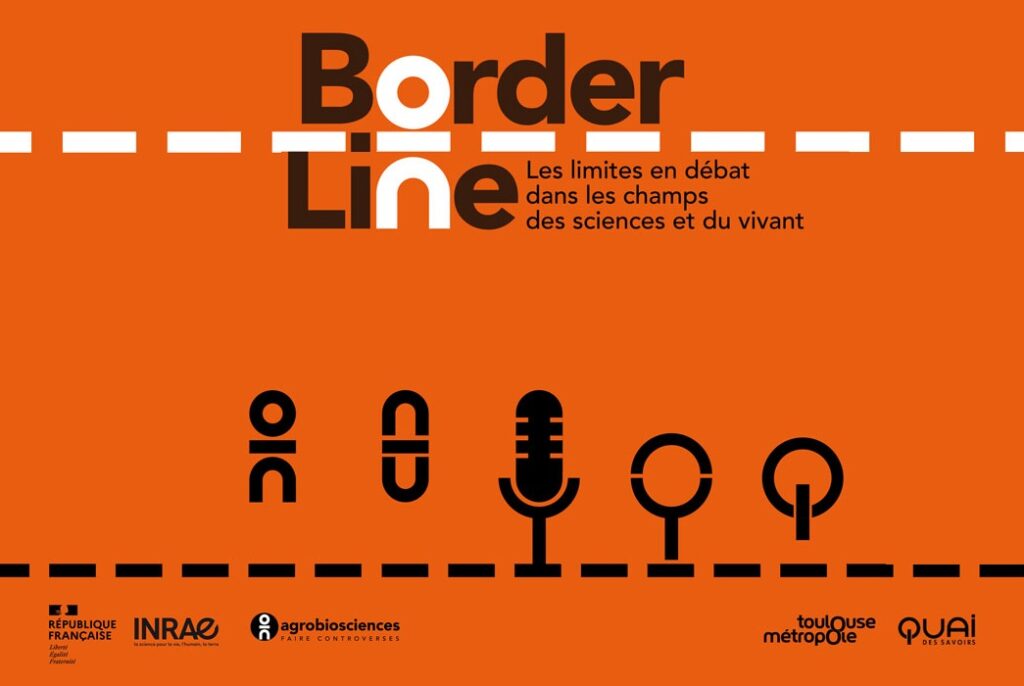- transitions

Le Quai des Savoirs prépare son avenir : une année de transformation en 2026
[ARTICLE] Pour ses dix ans, le Quai des Savoirs s’offre une métamorphose. À partir de novembre 2025 et jusqu’en septembre 2026, la grande salle d’exposition fermera ses portes pour laisser place à un chantier : la construction d’un auditorium de 120 places, baptisé « Agora des futurs ».